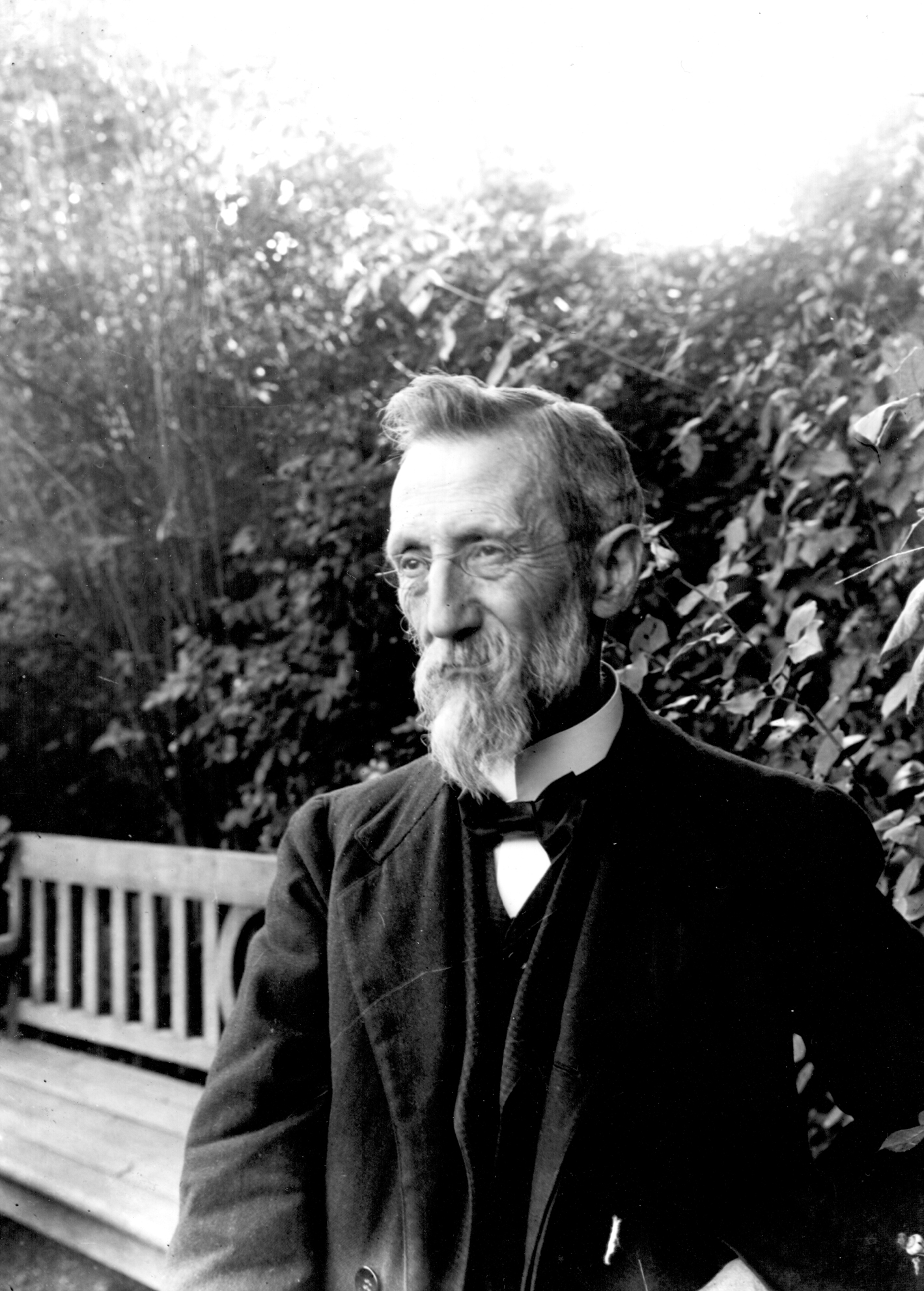C'est vers 1907 que Louis Hachette et Ferdinand Buisson convinrent d'une refonte et d'une nouvelle édition du Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire[^1]. Depuis les premiers fascicules de celui-ci, en 1878, et même depuis son achèvement, en 1887, la situation de l'enseignement avait complètement changé. Désormais l'instruction publique laïque était bien établie, les écoles normales formaient, année après année, les cohortes de cette armée qui allait, espérait-on, peu à peu former un nouveau peuple ; c'est du moins ce qu'escomptaient les promoteurs de ces réformes. Il fallait tenir compte de ces nouvelles réalités pour une nouvelle édition du Dictionnaire. L'ancien était dépassé sur de nombreux points, rendus caducs par les nouvelles lois et les institutions qu'elles avaient établies. Il fallait donc éliminer de nombreux articles, tenir compte des changements survenus dans les domaines traités par les autres et ajouter de nouvelles notices, consacrées aux personnalités entre temps disparues (Jean Macé, Félix Pécaut, par exemple) et aux nouvelles réalités (syndicats d'instituteurs, entre autres). D'autre part, le Nouveau Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, tel était devenu son titre, ne devait plus comporter qu'un seul volume, ce qui impliquait non seulement l'élimination de ce qui était devenu caduc et inutile, mais aussi la réduction voire la suppression d'articles demeurés valables. Comme en 1878 et 1879, Buisson fit appel à James Guillaume ; il n'était plus au ministère, mais ses tâches de professeur à la Sorbonne et ses autres activités ne lui laissaient guère de temps pour de nouvelles tâches éditoriales et, comme il l'avait fait auparavant, il recourut à son ancien collaborateur. Dans une lettre, comme à l'habitude non datée, il lui écrivait : « Il faudra reprendre des jours fixes pour nous voir et liquider les petites affaires courantes tous les 8 ou 15 jours. »[^2]
Quant à Guillaume, il avait tenu à fixer les conditions de sa collaboration : 5 fr. par colonne imprimée pour la reprise de ses propres articles ou la rédaction de nouveaux ; même tarif pour la relecture, la mise au point et la réduction des articles d'autres auteurs, de même que pour les traductions en français de textes d'autres langues ; pour la correspondance avec les auteurs, les conférences, les courses dans Paris, une indemnité forfaitaire de 15 fr. par feuille d'impression (16 pages, 32 colonnes) ; pour la révision des manuscrits, leur préparation pour l'impression et la lecture des épreuves, 50 fr. par feuille[^3]. Cela lui assurait une rémunération honorable et assurée jusqu'à l'achèvement du volume, en 1911.
Après avoir examiné les conditions dans lesquelles Guillaume avait travaillé à l'élaboration des deux Dictionnaires de pédagogie, il convient d'étudier de près la façon dont il y a collaboré et le contenu des articles qu'il y a rédigés. Dans quelle mesure a-t-il influencé le contenu du Dictionnaire pédagogique, en sa première et seconde partie et le choix de ses 358 collaborateurs, ainsi que ceux du Nouveau Dictionnaire de pédagogie (Titres respectivement abrégés par la suite en DP1 pour la première partie et DP2 pour la seconde et NDP pour le Nouveau Dictionnaire de pédagogie) ? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre car ses discussions avec Buisson n'ont pas laissé de traces écrites[^4]. Dès le début, en 1878, ce dernier avait déjà retenu de nombreux auteurs pour leur confier la rédaction de notices. En 1878-1879, les possibilités de Guillaume quant au choix des collaborateurs étaient limitées, même dans son propre pays, la Suisse. En effet Buisson avait déjà sous la main nombre de ses anciens collègues à l'Académie de Neuchâtel : le géologue Édouard Desor, Aimé Humbert et surtout le radical fribourgeois Alexandre Daguet, auquel il avait même proposé de prendre « la direction de toute la partie suisse »[^5], ce qui, finalement, ne se fera pas, Daguet se contentant de la rédaction de quelques articles. Il en avait même proposé un, pour la lettre D, consacré à sa propre personne et Buisson avait dû lui rappeler que le Dictionnaire ne publiait pas de notices sur des personnages vivants. Il est possible que Guillaume ait suggéré quelques noms de collaborateurs éventuels, surtout dans des États étrangers ; par exemple, c'est certainement lui qui a avancé celui de son ancien camarade de Zurich à la société de Zofingue, Otto Hunziker. Il lui avait envoyé les trois premiers volumes du DP, pour les faire figurer dans l'exposition permanente consacrée à Johann Heinrich Pestalozzi. Hunziker est l'auteur de l'article sur Ulrich Zwingli et de celui sur la Suisse. Comme Guillaume lui avait demandé la notice sur Johann Friedrich Herbart, le Zurichois avait demandé un délai jusqu'en mai, ce qui a paru trop long à Guillaume qui a eu alors recours à Sigmund Auerbach, leur collaborateur de Berlin[^6]. Hunziker est mort en 1909 ; dans le NDP, paru en 1911, sa notice sur la Suisse devait être actualisée ; elle a donc été confiée à Albert Gobat, radical bernois, membre du gouvernement cantonal et directeur de l'enseignement. Beaucoup plus courte que celle du DP, c'est un aperçu administratif des écoles de la Confédération vers 1910, dont a disparu tout l'intéressant historique que l'on trouvait chez Hunziker. Un étonnant parti pris, quand on connaît l'attrait de Guillaume pour l'histoire et les liens amicaux qui le liaient à Hunziker. Il est vrai qu'il ne faisait pas tout ce qu'il voulait, à la rédaction des dictionnaires.
Une seule initiative de Guillaume nous est connue, bien postérieure puisqu'elle se rattache à la préparation du NDP. Il s'agissait de préparer les notices relatives aux différents pays. On ne pouvait reprendre telles quelles celles du DP, la situation ayant évolué entre temps. Guillaume avait fait imprimer l'article déjà rédigé sur l'Espagne, dû à Manuel Bartolomé Cossio, et l'envoyait comme modèle aux auteurs sollicités. C'est ce qu'il fit avec Max Nettlau, lui demandant s'il pouvait lui recommander quelqu'un pour l'Autriche. Pour chaque pays, expliquait-il, il lui fallait trouver « un collaborateur instruit, compétent et indépendant qui puisse se charger de faire l'article relatif à ce pays. » La réponse de Nettlau ne nous est pas connue, car il se trouvait alors à Paris et a sans doute transmis verbalement à Guillaume le nom de Franz Roider, qui rédigera l'article. L'auteur, qui se limite donc à la partie « autrichienne » de la double monarchie (le Dictionnaire comporte un article Hongrie), montre que le développement du système scolaire est la fidèle image du développement politique ; il n'a pas d'allure uniforme et comprend de brusques variations. Il se caractérise par la lutte entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. Après Marie-Thérèse et Joseph II, souverains éclairés, favorables aux progrès de l'enseignement, ce sont les périodes de réaction, malgré les espoirs de 1848. Au début du XXe siècle, l'opposition au cléricalisme est le fait de la bourgeoisie libérale et de la classe ouvrière, organisée dans ses syndicats. En outre le problème des nationalités détermine l'évolution de l'enseignement : progrès de celui en langue tchèque, recul de celui en langue allemande, mais mécontentement des populations italiennes des provinces adriatiques et du Tyrol, qui se voient refuser un développement de l'enseignement en leur langue. Un excellent article, répondant sans doute aux attentes de Guillaume. Deux semaines plus tard, nouvelle demande : Nettlau ne connaîtrait-il pas quelqu'un pour se charger de la Hongrie ? Pourrait-il même, le cas échéant, s'en charger lui-même[^7] ? Là non plus nous ne connaissons pas la réponse de Nettlau, mais ce n'est probablement pas lui qui a suggéré le nom de Léon Buée, un juriste parisien, qui sera l'auteur de l'article.
Faut-il attribuer à Guillaume le recrutement des quelques communards qui figurent parmi les collaborateurs du Dictionnaire[^8] ? Même pas. Examinons leur brève liste : Élie et Élisée Reclus, Paul Martine, Paul Robin étaient déjà en relations suivies avec Buisson, bien avant l'engagement de Guillaume ; certes celui-ci connaissait aussi les Reclus et Robin, mais il ne connaissait probablement ni Martine ni Eugène Da Costa, autres communards collaborateur du Dictionnaire.
Guillaume a-t-il réussi à insérer, dans les deux Dictionnaires des notices relatives aux expériences et tentatives d'enseignement libertaire ? L'aurait-il même voulu ? Durant les travaux préparatoires des deux ouvrages, des anarchistes, reprenant le concept d'éducation intégrale développé par Bakounine et, à sa suite, Robin, s'étaient lancés dans des expériences pédagogiques originales. Robin et son orphelinat de Cempuis, Sébastien Faure et La Ruche, dans la forêt de Rambouillet, l'École moderne de Francisco Ferrer sont les plus connus. Cependant ils n'apparaissent dans aucun des deux Dictionnaires et Guillaume, dans sa correspondance, celle qui nous est parvenue tout au moins, ne mentionne jamais leurs expériences. Après l'achèvement des Dictionnaires, il connaîtra Albert Thierry, professeur à l'École normale de Versailles et auteur d'essais et d'articles novateurs relatifs à l'enseignement et qui participa à La Vie ouvrière ; mais Guillaume n'a jamais parlé de ses idées pédagogiques[^9]. Il s'indignera, comme beaucoup, de l'exécution de Ferrer, en 1909, qui lui avait par ailleurs rendu visite à Paris deux ans auparavant, pour faire sa connaissance et lui proposer de collaborer à sa revue internationale, L'École rénovée[^10], mais le NDP, paru après la mort du pédagogue espagnol, l'ignore complètement, même dans son article consacré à l'Espagne. Certes, la règle était de ne pas publier de notice consacrée à une personnalité vivante, ce qui était le cas pour Ferrer lors de la mise en chantier du NDP. Mais entre l'exécution de l'anarchiste espagnol, le 13 octobre 1909, et la parution du dictionnaire en juin 1911, le temps n'aurait pas manqué pour lui consacrer un article. Certes Guillaume n'avait pas les mains libres au Dictionnaire, on l'a dit, mais il y disposait tout de même d'une large autonomie. D'où, de nos jours, l'étonnement d'un chercheur :
Il est singulier que James Guillaume, qui consacre alors toute son énergie à la question pédagogique, n'ait pris semble-t-il, aucun intérêt à ces réalisations [de la pédagogie libertaire] et se soit contenté d'agir auprès de Ferdinand Buisson et des tenants de l'instruction laïque et obligatoire, dont les buts et les méthodes étaient fort éloignés de ceux définis par l'éducation intégrale. Cette attitude est d'autant plus surprenante que les anarchistes, vers 1900, mettent de plus en plus violemment en cause l'école, sous sa forme gouvernementale et laïque.[^11]
Le constat est exact, mais il n'est surprenant que si l'on oublie que Guillaume, justement, n'est pas l'anarchiste que beaucoup s'imaginent. Certes, dans ses Idées sur l'organisation sociale de 1876, il avait signalé que l'éducation intégrale pourrait commencer à se développer au moment où le collectivisme prendrait le pas sur le capitalisme. Mais cette éducation intégrale, telle que l'avait esquissée Bakounine et qu'elle sera développée par Robin, ne pouvait, aux yeux du révolutionnaire russe lui-même, être réalisée en régime capitaliste ; il l'a clairement indiqué :
Si dans le milieu qui existe on parvenait même à fonder des écoles qui donneraient à leurs élèves l'instruction et l'éducation aussi parfaites que nous pourrons les imaginer, parviendraient-elles à créer des hommes justes, libres, moraux ? Non, car en sortant de l'école ils se trouveraient dans une société qui est dirigée par des principes tout contraires, et, comme la société est toujours plus forte que les individus, elle ne tarderait pas à les dominer, c'est-à-dire à les démoraliser. Ce qui est plus, c'est que la fondation même de telles écoles est impossible dans le milieu social actuel. Car la vie sociale embrasse tout, elle envahit les écoles aussi bien que la vie des familles et de tous les individus qui en font partie. [^12]
Comment les enseignants pourraient-ils donner à leurs élèves ce qui leur manque à eux-mêmes ? « Donc l'éducation socialiste est impossible dans les écoles ainsi que dans les familles actuelles. Mais l'éducation intégrale y est également impossible [...]. » Et Bakounine de conclure de la façon la plus nette : « Non, messieurs, malgré tout notre respect pour la grande question de l'instruction intégrale, nous déclarons que ce n'est point là aujourd'hui la plus grande question pour le peuple. La première question est celle de son émancipation économique, qui engendre nécessairement aussitôt et en même temps son émancipation politique, et bientôt après son émancipation intellectuelle et morale. »
C'est à ce jugement de Bakounine que Guillaume était et demeurera toujours fidèle. En 1913 encore, il écrira :
Quant à l'instruction intégrale, son jour ne pourra venir qu'après la suppression du salariat, une fois que les syndiqués, ayant pris en main toute la production et réorganisé la consommation sur une base communiste, c'est-à-dire purement distributive et non plus mercantile, auront émancipé réellement les travailleurs aujourd'hui exploités. Alors l'instruction pourra être reçue par tous, à proportion non plus de leur situation économique, puisque toutes les situations seront devenues équivalentes, mais de leurs aptitudes intellectuelles.[^13]
D'où son manque d'intérêt pour des tentatives qui, à ses yeux, ne pouvaient réussir et qui n'avaient aucune prise sur le développement général de l'enseignement. C'est à celui-ci qu'il entendait se vouer, dans la mesure de sa modeste influence, par ses études historiques et sa collaboration étroite à l'œuvre de Buisson et des créateurs de l'école primaire laïque de la Troisième République. D'où son silence sur la pédagogie libertaire des Robin, Faure et Ferrer.
Guillaume avait connu Robin aux temps de la Fédération jurassienne, et l'avait retrouvé à Paris, en 1879, lorsque celui-ci y revient, après ses années anglaises. Est-ce Guillaume qui aurait suggéré à Buisson de confier à Robin des articles scientifiques de la seconde partie du Dictionnaire, comme le suggère la biographe de Robin[^14] ? Ce n'est pas impossible. Mais, par la suite, quand Robin aura pris la direction de son orphelinat, les rapports entre les deux s'espacèrent et finirent par se rompre, à cause, prétendra Guillaume, des « incohérences » du directeur de Cempuis qui l'ont brouillé avec Élisée Reclus[^15]. Si le nom de Robin apparaît parfois dans la correspondance ultérieure de Guillaume, c'est avec des connotations ironiques et plutôt négatives, au sujet entre autres de sa propagande anticonceptionnelle. En 1888, à propos de la plage de Mers où, avec sa famille, il avait séjourné deux étés, il écrit : « Nous y retournerions volontiers ; mais ce qui nous en empêche, c'est la présence de l'orphelinat Robin qui y va en vacances ; et j'ai des raisons personnelles, trop longues à expliquer, pour éviter ce voisinage. »[^16] De son côté, Robin affirmera ne plus avoir eu de relations avec Guillaume depuis 1888-1889 : « Nous avons évolué en sens inverse », écrira-t-il, avant de traiter son ancien camarade de « potentat de la boutique Hachette[^17] ». En 1905, il tentera de renouer avec lui, mais Guillaume gardera ses distances, lui reprochant son néo-malthusianisme : « Tu t'adonnes à une toquade que je ne puis approuver, qui a surtout le tort, à mes yeux, de ridiculiser la cause de l'émancipation du travail que tu prétends servir [...]. En tout cas, reconnaissait-il, tes intentions ont toujours été droites. C'est pourquoi, malgré ce qui nous sépare aujourd'hui, je puis te serrer la main en souvenir du passé. » Et Gabriel Giroud, le beau-fils de Robin, qui cite cette lettre dans la biographie qu'il lui a consacrée, attribue l'hostilité de James Guillaume, de Pierre Kropotkine, d'Élisée et d'Élie Reclus à l'égard du néo-malthusianisme et de l'eugénisme de Robin à leur mentalité puritaine et à leur entêtement doctrinal[^18]. Ce qui est certain, dans tout cela, c'est que Guillaume ne s'intéressait nullement à l'orphelinat en tant qu'expérience et modèle d'éducation nouvelle.
Autre expérience, celle de Sébastien Faure. En 1904, Guillaume ne le connaissait pas et n'avait rien lu de lui. Mais, renseigné par la presse, il avait blâmé ses exagérations, en présence d'un admirateur, secrétaire des Jeunesses syndicalistes, qui lui fit lire les articles que Faure avait publiés, l'année précédente, dans Le Libertaire. « J'ai été stupéfait de constater que S. F. a les mêmes idées que moi : si j'avais eu à traiter la question, je n'aurais pas dit autre chose que lui », avouera-t-il alors[^19]. Ce n'est qu'en septembre 1906, lors de ses vacances en Suisse, que Guillaume aura l'occasion de faire la connaissance personnelle de Faure. À Neuchâtel, en compagnie de son ami, le peintre Gustave Jeanneret, il s'était rendu à une soirée consacrée à l'école libertaire La Ruche, fondée et dirigée par le célèbre conférencier anarchiste en 1904, près de Rambouillet. Ce dernier avait organisé une tournée en Suisse pour y présenter son institution et y récolter des fonds. Introduits par lui, un certain nombre de ses pupilles s'y produisaient : chants, saynètes, déclamations... La soirée avait été assez longue et Jeanneret n'avait pu rester jusqu'à la fin. D'où le bref récit que lui en adresse Guillaume : « La soirée Sébastien Faure a duré jusqu'à minuit. J'en ai emporté une impression plutôt favorable, et c'est dommage que tu n'aies pu rester jusqu'à la fin. Après que tout a été terminé et les enfants mis au lit, j'ai causé un quart d'heure avec Faure, et lui ai trouvé l'esprit ouvert et non sectaire. »[^20] Une appréciation qui, semble-t-il, porte plus sur les idées générales du conférencier anarchiste que sur sa conception d'une pédagogie libertaire.
Si Guillaume parlera parfois de l'École Ferrer de Lausanne, une autre tentative d'enseignement libertaire, plus tardive, ce ne sera que pour déplorer les dissensions qu'elle avait provoquées entre militants de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. Aussi avait-il conseillé à Henri Baud, militant syndicaliste de Lausanne, d'envoyer au diable l'École Ferrer[^21]. Peu après, il écrira à son ami Fritz Brupbacher, le 28 février 1911, à propos des militants de Suisse romande : « Il faudrait leur faire comprendre que cette école n'est rien en comparaison des grands intérêts qu'ils sont en train de compromettre. S'ils persistent à se quereller pour cette bagatelle, ils tueront la Voix [du peuple] et la Fédération. »[^22] Et l'année suivante encore, il parlera de « la sotte querelle de l'école Ferrer (dont la fondation a été une grande faute) »[^23]. De même, d'une façon plus générale, il n'a bien sûr jamais cru à « l'émancipation par les savoirs », pour reprendre le titre fallacieux d'une manifestation universitaire récente[^24].
Pour en revenir aux Dictionnaires, relevons que, si les expériences d'éducation libertaire n'y trouvent aucun écho, les idées et les conceptions de James Guillaume apparaissent nettement dans les articles qu'il a rédigés, qu'il les ait signés ou non, ainsi que dans ceux auxquels il a été appelé à collaborer. On a vu, à propos de ses Esquisses historiques de 1875, l'intérêt et l'amour qu'il ressentait à l'égard de la civilisation grecque ancienne. C'est sans doute ce qui l'a incité à se charger de l'article « Athéniens (éducation chez les...) »[^25]. Mais c'est surtout sa sympathie évidente pour les révolutionnaires de 1793-1794 et son aversion envers leurs adversaires et ceux qui, comme Bonaparte, ont utilisé la Révolution comme marchepied pour accéder au pouvoir qui caractérisent ses contributions personnelles aux Dictionnaires. Relevons toutefois l'importance et l'étendue de certains de ces articles, dont celui consacré à la Convention et celui sur Pestalozzi.
Un exemple nous montrera comment Guillaume a conduit ses recherches historiques pour les deux éditions du Dictionnaire : l'article sur Fleuri de Paulet ou Pawlet. Publié d'abord dans les livraisons de 1885, il concerne, y lit-on, un « gentilhomme irlandais », établi en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui avait ouvert, en 1772, une École des orphelins militaires. Guillaume cite assez longuement le témoignage d'Etienne Macdonald, que Napoléon avait fait maréchal de France et duc de Tarente sur le champ de bataille de Wagram et qui était un ancien élève de l'institution ; celui-ci y expliquait comment les élèves se gouvernaient eux-mêmes, grâce au système d'administration et d'enseignement mutuel mis en place par Paulet. La Révolution avait détruit cette école. Guillaume relevait encore le rapport du conventionnel Claude Laurent Masuyer (avec renvoi à l'article consacré à celui-ci, non signé mais certainement de sa plume). Autre source : un article de Charles Pictet de Rochemont que Guillaume dit avoir vainement recherché, à Paris et à Genève, car il était indiqué avec une référence manifestement fausse.
En 1891, il revient sur le sujet dans la Revue pédagogique, puis en 1897 dans un second article de la même revue, rectifiant sur quelques points le premier. Il reprendra ces textes avec un complément dans la seconde série de ses Études révolutionnaires[^26], puis dans le Nouveau Dictionnaire. Nous avons là tous les éléments successifs d'un work in progress, un témoignage de première main sur la démarche du chercheur. Dans sa contribution de 1891, il explique que, sous la Restauration, les fondateurs de la Société pour l'instruction élémentaire, voulant introduire en France l'enseignement mutuel mis au point par les Anglais Lancaster et Bell, crurent faciliter l'adoption de cette nouveauté en lui cherchant des précurseurs français. D'où le recours à Paulet/Pawlet, auquel Louis XVI s'était intéressé. « Invoquer le souvenir de Pawlet, c'était placer l'enseignement mutuel, en butte à la malveillance des royalistes ultra, sous l'égide du "roi martyr". » Malheureusement, en 1885, Guillaume s'était fié aux indications erronées de la Société pour l'instruction élémentaire, publiées en 1816. Il n'y pensait plus lorsqu'au printemps 1891 il avait découvert, dans un carton des Archives nationales, de nouvelles pièces relatives à Pawlet, ce qui l'avait incité à reprendre ses recherches sur celui-ci. « Un heureux hasard m'a fait rencontrer alors à la Bibliothèque nationale les deux volumes d'un magazine anglais » de 1788-1789, le Repository ; il l'avait auparavant vainement recherché sous le titre de Repertory, faussement donné par la publication française de 1816. Il y avait trouvé la description de l'établissement du chevalier Pawlet ainsi que la référence correcte à l'article du Genevois Pictet de Rochemont : le Journal de Genève et non la Bibliothèque britannique, qu'il avait vainement dépouillée en 1885. Une première recherche dans le Journal de Genève de Jacques Mallet du Pan, publié à Paris, le seul que possédait la Bibliothèque nationale, demeura vaine. « J'appris ensuite qu'il s'était publié à Genève même, en 1787 et 1788, un autre Journal de Genève, hebdomadaire comme le premier, mais de format in-4^o^, dont la bibliothèque de Genève possède un exemplaire. » C'est là que Guillaume y découvrit enfin la relation de Pictet de Rochemont[^27]. Comme il l'écrit, « un bonheur n'arrive jamais seul : presque en même temps, une obligeante indication due à M. Maurice Tourneux [...] me faisait mettre la main sur un document resté complètement ignoré jusqu'à présent », une notice sur l'École des orphelins militaires. Celle-ci, contrairement à ce que Guillaume avait cru en 1885, n'avait pas disparu durant la Révolution. Pour 1789-1793, il avait retrouvé les indications essentielles permettant d'en suivre les vicissitudes. Pawlet, qui avait d'abord accueilli la Révolution avec faveur, avait émigré après la chute de la monarchie (on perd alors définitivement sa trace). Mais son établissement avait alors été pris sous la protection de la section de Popincourt et secouru par la Convention.
Dans son second article, de 1897, Guillaume pourra encore ajouter de nombreuses indications complémentaires sur l'existence de l'école fondée par Pawlet, entre 1793 et sa fin, par sa réunion à un autre établissement durant l'été 1795. Il le fit en empruntant nombre de celles-ci au manuscrit du tome 4 de ses Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale, pas encore publiés. En 1909, il ajoutera encore une note complémentaire sur l'identité de Paulet/Pawlet. Grâce au Dictionnaire critique de biographie et d'histoire de Auguste Jal, « un fureteur émérite », comme il le qualifie, on sait que la « copie » de l'acte de naissance de Paulet, fournie par celui-ci à son régiment pour y obtenir le grade de cornette, en 1760, diffère notablement de l'acte original : Fleuris Paulet y est rajeuni de six ans ; son père, Pierre Paulet, « m^d^ de bleds », devient marquis de Black ; son parrain, Fleury Martin, un « me tonnelier », est promu « S^r^ de Tonnillier » ; l'époux de la marraine, un « me fabricant » nommé Antoine Guédan, s'anoblit en « de St-Fabricq ». Quant à Paulet lui-même, qui n'a bien sûr rien d'irlandais, il signera successivement Fleury Pawlet de Caumartin (sans doute du nom de son parrain, Martin), du Paulet de Commartin et Le Ch. de Pawlet. Ce qui nous vaut ce commentaire de Guillaume : « La "copie" de cet acte [...] nous offre un exemple amusant de la façon dont, sous l'ancien régime, un roturier se forgeait à bon marché, avec la complicité souriante de tout le monde, une noblesse de fantaisie qu'on acceptait en fermant les yeux. » Dans le NDP, il relèvera : « Cette façon de se forger une noblesse imaginaire était d'usage courant au dix-huitième siècle. » Et la notice, revenant sur la disparition de Pawlet après son émigration, concluait : « Peut-être, dans l'avenir, la mise au jour de quelque document encore ignoré permettra-t-elle d'achever sa biographie. » On sait aujourd'hui que le « chevalier Pawlet » avait encore l'intention, en 1806, de bâtir une école au haut des Champs-Élysées et que par la suite il passa en Espagne ou il mourut en 1809[^28].
Les nouvelles recherches de Guillaume lui avaient permis d'étoffer notablement son article du NDP par rapport à celui du DP1 : 7 colonnes et demie contre une et demie. C'est ce qui l'incitera sans doute à sacrifier l'article sur Masuyer du DP, le conventionnel étant désormais suffisamment présent dans l'article Pawlet, sans parler de l'article Convention. On voit, par cet exemple, comment travaillait Guillaume. Toujours prêt à revenir sur ses publications antérieures en fonctions de ses découvertes successives, il attribue souvent celles-ci à un heureux hasard. Toutefois, s'il y a bien hasard, il faut souligner qu'il est en quelque sorte sollicité par l'activité incessante du chercheur infatigable qu'est Guillaume : le « hasard » joue, certes, mais sur un terrain bien préparé, celui des nombreux cartons d'archives et non moins nombreux volumes de bibliothèques qui ont été dépouillés, sans compter les informations dues aux contacts personnels avec d'autres chercheurs et auteurs.
Guillaume ne rédigea pas seulement des notices relatives à des personnages qui lui étaient sympathiques ; il lui arriva aussi de devoir se charger de la biographie d'hommes à l'opposé de ses convictions personnelles. Il le faisait en respectant les règles de la critique historique et en conservant une certaine objectivité, même s'il ne se dispense pas de quelques appréciations personnelles. Voici un exemple de sa façon de procéder. Dans une lettre à son père, le 2 juin 1882, il écrit : « En ce moment, je travaille à une étude sur Froebel, qui va faire, à ce que m'annonce M. Buisson, quelque bruit dans le landerneau : ce sera la première fois qu'on aura un Froebel authentique, portraicturé [sic] sur des documents originaux, et bien différent de celui de la légende : les froebeliens ne seront pas contents. »[^29]
Le Froebel « de la légende » n'était pas un inconnu, dans la famille de James Guillaume. En 1877-1878, ses sœurs avaient envisagé de fonder une école froebelienne dans la maison familiale de Rosevilla à Neuchâtel. Pour cela, elles avaient été suivre un cours à Genève, chez M^me^ de Portagall, l'une des principales introductrices du pédagogue allemand dans les pays francophones. Mais le projet était demeuré sans suite[^30]. Il avait rencontré le scepticisme de leur frère aîné, qui n'était sans doute pas fâché, quelques années plus tard, d'opposer la véritable pensée du maître au portrait quelque peu simplifié et édulcoré que diffusaient ses disciples.
Grâce aux ouvrages en langue allemande lus par Guillaume, son article est novateur ; son début indique bien les intentions de son auteur : « Depuis une vingtaine d'années, le nom de Froebel jouit d'une popularité toujours croissante ; ses admirateurs voient en lui l'initiateur d'une transformation radicale dans l'éducation de la première enfance, de laquelle ils attendent la régénération de l'humanité. » Inutile de rappeler combien Guillaume était opposé à de telles croyances. Pourtant, poursuit-il, « la personne de Froebel et ses écrits sont restés, jusqu'à ce jour, presque inconnus en France ; on invoque le nom du réformateur, on emploie son matériel d'enseignement, sans bien savoir au juste ce que sont ses doctrines. Nous avons cru, en conséquence, qu'il serait utile de mettre sous les yeux de nos lecteurs un exposé détaillé de la vie et des idées du fondateur des jardins d'enfants, qui permît de se former une idée exacte de ce que Froebel a pensé, et de se rendre compte de la valeur réelle des innovations qu'il a proposées. » Suit alors un long exposé, pas moins de 28 colonnes sur quatorze pages, qui se conclut par une longue bibliographie, à elle seule plus de deux colonnes.
Comme toujours, Guillaume est très documenté, il s'appuie sur les écrits mêmes de Froebel et sur une impressionnante liste d'études. Mais, dans son exposé détaillé et soigneusement étayé, il met délibérément l'accent sur un certain nombre de caractéristiques de nature à provoquer un rejet de la part d'un lecteur rationaliste et libre-penseur, comme l'était fréquemment l'instituteur laïque de la Troisième République. Il y a d'abord l'existence même de Froebel, passablement agitée et instable : « Il semble que son caractère ne lui permît pas de suivre un projet avec quelque persévérance. » Mais il y a surtout, dès le début, ce qui va devenir le fondement de sa philosophie éducative : « Il cherchera à réaliser l'union complète de l'homme et de la nature. L'univers dont l'homme est une partie, forme un grand tout harmonieux. » Il s'inspire de Schelling et lit « les écrits du mystique Novalis ». Arndt « éveille chez lui la fibre patriotique, et lui fournit les éléments d'une philosophie de l'histoire, dont le trait le plus saillant semble avoir été [...] l'exagération du sentiment national poussé jusqu'au "teutonisme" ». La grande comète de 1811 l'amène à élaborer sa « loi du sphérique », loi générale du monde physique et moral. « Ces vues mystiques de Froebel [...] seront [...] le fondement de sa doctrine éducative, en ce qu'elle a d'original et de personnel. » Par la suite il élabore un « symbolisme des formes géométriques », les faisant toutes dériver d'une forme supérieure unique ; il élabore une théorie des nombres, inspirée de Pythagore. « Il n'est pas jusqu'aux lettres de l'alphabet qui ne devinssent, pour ce rêveur égaré à la recherche de l'absolu, prétexte à des interprétations mystiques. » Et de citer quelques exemples significatifs, avec ce commentaire final : « Nous traduisons littéralement, sans chercher d'expliquer. » La pédagogie pratiquée par Froebel en son institut de Keilhau est sans originalité « à part les conceptions mystiques que Froebel avait ajoutées à la méthode pestalozzienne ». S'il continue à se considérer comme luthérien, il se rattache en fait à « un théisme mystique inclinant au panthéisme ». Sa conception de la nature n'est pas celle des scientifiques ; au lieu de la fonder sur l'expérience, « il part de l'apriori et de l'absolu », comme Schelling et Hegel.
C'est alors qu'il dirigeait l'orphelinat de Berthoud (Burgdorf), où l'avait appelé le gouvernement bernois, en 1835, que Froebel eut sa révélation, en observant des enfants jouer au ballon. Le ballon, image de la sphère idéale, la « loi du sphérique » ; pourquoi ne pas utiliser ce jouet, avec d'autres, méthodiquement gradués, pour initier inconsciemment les âmes enfantines « aux lois métaphysiques qui régissent l'univers, à les mettre en communication avec la pensée divine qui est au fond de toute chose et que sa propre existence divine manifestera ». D'où l'invention de cet ensemble d'objets à manipuler par les jeunes enfants et de jeux éducatifs qui connaîtra le succès. C'est le début de la dernière partie de l'existence de Froebel ; il s'y engage « plein d'enthousiasme à la pensée qu'il possédait enfin la vérité de laquelle allait sortir une humanité nouvelle et son monde nouveau ». Une croyance avec laquelle Guillaume prend ses distances, laissant bien entendre qu'elle lui est totalement étrangère. Sa conclusion générale est claire : « Il est impossible de méconnaître en Froebel, non pas précisément le génie, mais ce que les Allemands appellent la "génialité", c'est-à-dire ce je ne sais quoi qui distingue un homme du vulgaire et fait de lui une individualité supérieure, un caractère original. » Quant au « fondement soi-disant philosophique de son système : les citations que nous en avons faites ont permis au lecteur de l'apprécier [...] ». Aujourd'hui, « Résignés désormais à nous contenter du relatif, nous n'aspirons plus à la possession de l'absolu : l'âge de la métaphysique est passé sans retour ». Cette conclusion bien dans l'esprit du positivisme, Guillaume l'étend à l'ensemble de la pédagogie : « La science de l'éducation n'est pas faite : elle s'élabore lentement à mesure que nos connaissances en physiologie, en psychologie, en sociologie deviennent plus étendues et plus certaines. Mais on peut affirmer dès à présent que les matériaux que nous ont légués les divers inventeurs de systèmes n'entreront que pour une faible partie dans la construction de l'édifice définitif. »[^31]
Nous ignorons tout de la réaction des « froebeliens enragés » dont parlait Guillaume dans la lettre à son père. Beaucoup d'adeptes attachaient moins d'importance aux vues théoriques du maître qu'à ses préceptes pratiques pour l'éducation des jeunes enfants. On pouvait fort bien recourir aux jouets et jeux inventés par Froebel sans adopter les considérations philosophiques qui avaient présidé à leur élaboration, voire en les ignorant totalement. Une étude sur l'influence du pédagogue allemand en Suisse romande relève d'ailleurs que « les fondements philosophiques et religieux de la pédagogie froebelienne ne semblent guère pris en compte »[^32]. Quant aux disciples plus familiers avec les bases mêmes de la pensée du maître, il leur aurait été difficile de s'en prendre au Dictionnaire et à son article, scrupuleusement fondé sur les écrits de Froebel lui-même et sur les publications le concernant. La méthode choisie par Guillaume : dévaloriser le personnage aux yeux de son lectorat par l'exposé détaillé de ses croyances et affirmations successives, s'avérait impossible à réfuter, même si les intentions hostiles de l'auteur étaient manifestes. L'article Froebel constitue un excellent exemple de la manière dont Guillaume réussissait à concilier ses propres convictions avec les exigences de l'ouvrage dirigé par Buisson.
Prenons maintenant le cas d'un des huit nouveaux articles qu'il introduit dans le NDP, celui consacré à Saint-Lambert. Il s'agit d'un personnage secondaire, connu pour ses relations avec les philosophes et les encyclopédistes et pour ses conquêtes féminines ; ses liaisons avec la marquise du Châtelet et la comtesse d'Houdetot sont les plus connues. Le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse en parle en ce sens, dans son volume paru en 1875, et à sa lecture on ne comprendrait pas ce qui justifie sa présence dans un dictionnaire pédagogique. Mais Guillaume, qui l'a probablement étudié postérieurement à l'achèvement du premier Dictionnaire de pédagogie[^33], est d'un autre avis. À la lecture de sa notice, on comprend ce qui l'a attiré vers ce personnage. Ce marquis de Saint-Lambert (1716-1803), un des derniers représentants de cette école des Encyclopédistes, jouit déjà à ce titre de la sympathie de Guillaume. Mais surtout, plus qu'octogénaire, il a publié, sous le Directoire, un ouvrage de philosophie morale : Principes des mœurs chez toutes les nations, ou Catéchisme universel, 1798. Le Catéchisme proprement dit, qui figure au deuxième volume, sera réédité, deux ans plus tard, à un prix modéré et destiné « aux pères de famille et aux instituteurs ». Alors que le Larousse se bornait à mentionner le livre initial, ajoutant qu'il « ne répondait guère, au moment où il le publia, aux besoins du moment », Guillaume en fait l'analyse, montrant ce qu'il apporte à la pédagogie, d'où sa présence dans les colonnes du NDP et l'analyse qui en est faite. Relevons-y ce qui concerne « l'examen de soi-même » avec les recommandations sur l'emploi du temps de loisirs laissé par le décadi (le dixième jour du calendrier révolutionnaire alors en vigueur) ; cela en une longue citation de près d'une demi-colonne. Guillaume justifie ainsi ses nombreux détails : « Nous donnons ces renseignements bibliographiques parce que ceux qu'on trouve chez Quérard et ailleurs manquent de clarté et de précision. » La publication de Saint-Lambert, comme le relève Guillaume, suscita la « colère du parti religieux » et les « éloges du parti philosophique ». Mais le concordat de 1801, entre Bonaparte et le pape, montra que, « si le futur empereur mettait une fois un catéchisme entre les mains des écoliers, ce ne serait pas celui de Saint-Lambert ». En revanche, il sera mentionné d'une façon très élogieuse dans un rapport sur la littérature française depuis 1789, rédigé par Marie-Joseph Chénier, l'ancien conventionnel devenu membre de l'Institut. « Ces lignes éloquentes de Chénier ne virent le jour qu'en 1815 ; mais en plein despotisme impérial, le Catéchisme de Saint-Lambert allait devenir l'occasion d'une manifestation de pensée indépendante lorsque l'Institut eut à présenter un rapport sur les prix décennaux, manifestation qui doit être signalée. » En effet, Saint-Lambert fut proposé pour un grand prix de 1^ère^ classe, à la grande colère du parti anti-philosophe. Guillaume relate ensuite toutes les circonstances qui empêchèrent de décerner le prix au Catéchisme. « Mais l'ostracisme dont il a été l'objet a mieux contribué à faire vivre le souvenir de cet ouvrage -- qui n'est pas d'ailleurs un chef-d'œuvre -- que n'eût pu le faire la distinction qui lui fut refusée. »
On peut toutefois se demander, à la lecture de cette notice, si sa place n'aurait pas été dans une revue historique spécialisée plutôt que dans un dictionnaire à l'usage des instituteurs. D'ailleurs, dans une lettre malheureusement non datée, mais probablement sans rapport avec l'article Saint-Lambert, Buisson faisait quelques réserves sur la propension de son collaborateur à reprendre, pour le NDP, des notices de pure érudition qui figuraient dans le DP: « Il me semble que vous avez laissé subsister un nombre considérable d'articles d'érudition sans intérêt de la 1^ère^ édition. Tant pis. Mais il faudra tout de même nous entretenir avec M. Bréton. »[^34]
Venons-en à cet immense article Convention : pas moins de 117 colonnes, soit 51 pages dans le DP et 101 colonnes, soit 41 pages dans le NDP, avec une composition typographique légèrement différente, il est vrai, ce qui représente presque 2% du volume (2087 p.)[^35]. Première remarque, la notice du DP a paru d'abord en livraisons, en novembre 1879. Cela témoigne de l'ampleur des recherches entreprises par Guillaume depuis son arrivée à Paris, un peu plus d'un an auparavant. Depuis longtemps, certes, il s'intéressait à l'histoire de la Révolution et, avant 1878 déjà, il en avait une bonne connaissance. Mais en Suisse, en dehors des ouvrages de la bibliothèque paternelle et des collections publiques, il n'avait guère trouvé que le Moniteur, dont il avait découvert une collection empoussiérée à Zurich et dont il n'avait disposé que durant peu de temps. La lecture de l'article Convention est proprement stupéfiante ; comment son auteur a-t-il réussi, en si peu de temps, à réunir une telle somme de connaissances ? Il y a déjà là, en bonne partie, l'ossature de son édition des procès-verbaux des comités d'instruction publique de la Révolution, six volumes parus de 1889 à 1907, dont il sera encore question plus loin. Notons que, dans cette notice, il relève que « le Comité d'instruction publique, à la merveilleuse activité duquel on ne peut d'ailleurs que rendre hommage, a cependant joué un rôle moins important qu'on est d'ordinaire porté à la croire dans l'élaboration des plans d'éducation nationale ». C'est cette constatation qui l'amènera, quand il en éditera les procès-verbaux, à les accompagner d'une foule de pièces complémentaires relatives aux séances de la Convention, aux commentaires de la presse et aux opinions des différents acteurs. L'article du NDP, paru en 1911, un peu moins long, bénéficie des études de Guillaume et des autres historiens de la Révolution, parues durant le quart de siècle qui sépare les deux Dictionnaires ; d'autre part il est mieux coordonné avec d'autres notices consacrées à des personnages ou à des institutions de la période révolutionnaire. De plus, souvent, ses jugements sont plus nets et plus tranchants que ceux de 1879. Sans doute l'auteur se sent-il plus libre, plus assuré et mieux documenté qu'il ne l'était lors du premier DP. C'est pourquoi on se référera de préférence à cette seconde version.
Comme on l'a dit, dès 1879, l'auteur avait déjà accumulé tout le matériel pour pouvoir reproduire, dans son article, le texte complet des décrets relatifs à l'organisation de l'instruction publique votés de 1792 à 1795 et résumer l'essentiel des procès-verbaux de la Convention, les rapports et discours imprimés de ses membres et, dans certains cas, des articles de journaux. C'est déjà l'ébauche de ses six volumes de Procès-verbaux, parus à partir de 1889. Son exposé, affirme-t-il, est « jusque dans les moindres détails puisé aux sources originales », même s'il a dû, regrette-t-il, renoncer, pour des raisons de place, aux notes de référence. L'article, précise-t-il encore, ne prétend pas être une histoire de la Convention, mais une analyse détaillée de tout ce qu'elle a fait dans le domaine de l'Instruction publique. Ce n'est pas un texte d'une lecture facile ; le souci de l'exactitude et de la précision amène son auteur à des énumérations, à des résumés et à des analyses assez sèches de nature à rebuter le lecteur peu averti. Sans doute tenait-il à fonder son argumentation sur des preuves irrécusables, en une époque où l'histoire de la Révolution était encore décriée par les adversaires de la République.
Aussi, le lecteur persévérant trouvera tout le matériel nécessaire pour se faire une idée sérieusement fondée des problèmes de l'enseignement et de l'instruction publique au temps de la Convention. Guillaume ne manque pas de remettre ces propositions et ces débats dans leur contexte plus général, tout en suivant un ordre essentiellement chronologique. C'est ainsi que le plan de Michel Lepeletier, déjà rédigé au moment de son assassinat, le 20 janvier 1793, ne sera vraiment analysé par Guillaume que lorsqu'il relate sa lecture à la Convention, en juillet, ce qui lui permet d'en citer de larges extraits, avant d'analyser les discussions auxquelles il donna lieu. Finalement, celles-ci se conclurent par un échec des partisans du plan Lepeletier. Si Robespierre en prit assez facilement son parti, ce ne fut pas le cas de certaines sections parisiennes qui pétitionnèrent en faveur des idées du conventionnel assassiné, relève encore Guillaume, très attentif à ce qui différenciait et opposait les sections populaires de Paris au Comité de salut public et à la Convention. Cela ne l'empêche pas de relever le caractère extraordinaire de ce moment de l'histoire :
Ce mois d'août pendant lequel la Convention trouva le temps d'achever la discussion du plan de Lepeletier et de voter nombre de décrets relatifs à divers objets d'instruction publique, qui ne sauraient trouver place ici, c'est le plus formidable des mois de la formidable année 1793. Une moitié de la France était en pleine révolte contre la République, et des armées d'invasion menaçaient de toutes parts de pénétrer jusqu'au cœur de son territoire. On sait quelles mesures de suprême énergie la Convention dut prendre pour la défense de la cause populaire, et comment le décret du 23 août sur la levée en masse mit sur pied, d'un coup, "le peuple français debout contre les tyrans".
Le Comité d'instruction publique et la Convention à sa suite s'occupent fréquemment de sujets qui vont bien au-delà de l'organisation de l'enseignement ; Guillaume n'hésite pas à les suivre et à se laisser entraîner bien plus loin que ce qu'il avait annoncé dans son introduction. C'est le cas avec les fêtes décadaires, dont il résume les débats à leur sujet, pour ensuite en quelque sorte se reprendre : « Comme nous l'avons dit, il n'entre pas dans le cadre de cet article de retracer l'œuvre de la Convention en ce qui concerne les arts, les sciences, les monuments, les musées, etc. [... ni] du mouvement qui se manifeste partout à la fois, dans les lettres, dans la musique, au théâtre, dans les sciences, dans l'industrie et qui a fait du printemps de l'an II une des époques les plus fécondes et les plus brillantes que l'histoire ait à signaler. Mais nous laissons tout cela de côté pour nous limiter à ce qui concerne l'organisation des écoles. » Cependant c'est pour ajouter aussitôt une citation d'un rapport de Bertrand Barrère sur « l'état de la fabrication révolutionnaire du salpêtre et de la poudre ». Ce qui justifie la présence de ce texte, apparemment bien éloigné de l'instruction publique, c'est son appel aux masses populaires pour les inciter à lessiver les voûtes des anciens bâtiments et des caves afin de récupérer le salpêtre indispensable à la fabrication de la poudre à canon. Avec la collaboration de savants, au premier rang desquels Gaspard Monge, on avait mis au point des instructions précises relatives aux recettes et méthodes à employer. Pour les diffuser, on avait fait venir à Paris deux délégués de chaque district (quelque 800 personnes), en plusieurs sessions successives, C'est pour cela que Barrère y voyait « un nouveau mode d'instruction » ; et, généralisant, il ajoutait : « Ce mode révolutionnaire de cours publics est devenu pour le Comité [de salut public] un type d'instruction qui lui servira utilement pour toutes les branches des connaissances humaines utiles à la République ; et vous ne tarderez pas en sentir le besoin au milieu d'une ligue vandale ou visigothe qui veut encore proclamer l'ignorance, proscrire les hommes instruits, bannir le génie et paralyser la pensée. » Guillaume, sensibilisé depuis ses années de jeunesse au Locle, à la diffusion des connaissances dans les masses populaires, ne pouvait résister à l'envie de transcrire cette citation. Ajoutons que les historiens du XXe siècle l'ont suivi sur ce point, et n'ont pas manqué de souligner l'originalité de cette collaboration des scientifiques et des masses populaires.
Malheureusement le 9 Thermidor « changea l'orientation du gouvernement et arrêta le mouvement révolutionnaire », écrit Guillaume, malgré la réserve qu'il manifeste à l'égard de Robespierre, dont il n'apprécie pas les références à l'Être suprême et qu'il critique pour sa répression du mouvement sectionnaire. Cependant la Convention, jusqu'à sa séparation, le 26 octobre 1795, poursuivit son œuvre dans le domaine de l'enseignement. Mais, pour Guillaume :
La législation scolaire de l'an IV est le témoignage de la déchéance intellectuelle et morale de la Convention après l'arrêt de l'élan révolutionnaire et l'extermination successive des meilleurs républicains. L'enseignement primaire et l'enseignement supérieur, ces deux bases de l'instruction publique, sont sacrifiés. Dans l'enseignement primaire on a renoncé à la gratuité et à l'obligation, et l'instituteur redevient le misérable magister de l'ancien régime, réduit pour vivre aux redevances de ses élèves. Pour l'enseignement supérieur, la loi du 3 brumaire contient une brillante énumération d'écoles supérieures spéciales, seulement ces écoles n'existent pas, à l'exception des Écoles de santé. Par contre on a organisé ou réorganisé les écoles de services publics, pour fournir à l'État les fonctionnaires dont il a besoin, et, par la fondation des écoles centrales, on a créé la pépinière d'où ces fonctionnaires sortiront.
Mais ces écoles centrales, « que rien ne relie aux écoles primaires négligées et avilies, [...] resteront une création artificielle, impuissante à faire pénétrer dans la masse du peuple cet esprit scientifique dont elles étaient censées être les représentantes. L'œuvre qu'avaient rêvée les meilleurs parmi les hommes de la Révolution était manquée, leur vaste entreprise avait avorté ». Par la suite, le Consulat consomme le retour à l'ancien régime, supprimant « tout ce qui subsistait encore des aspirations de 1789 et de 1793 » et « transformant les écoles centrales en lycées et l'École polytechnique en caserne ».
Un bilan décevant, pour Guillaume, qui ajoutait aussitôt : « Mais il serait souverainement injuste de rendre les révolutionnaires responsables de leur échec, et de n'apprécier leur effort qu'à la mesure du résultat obtenu. Cette injustice, nul ne la commettra de ceux qui, selon une expression de Jean Jaurès, se seront "pénétrés de la grandeur des pensées qui visitèrent, dans la lueur de l'orage, l'esprit révolutionnaire". » Les quatre volumes de l'Histoire socialiste consacrés à la Révolution avaient paru de 1901 à 1903. Dans la partie consacrée à La Convention, Jaurès publie un portrait de Pestalozzi, indiquant que cette gravure a paru dans la biographie écrite par Guillaume et qu'elle est « reproduite avec l'autorisation de l'auteur »[^36]. C'est en janvier 1902 que les deux hommes s'étaient rencontrés et que Guillaume avait envoyé son Pestalozzi à Jaurès[^37]. Celui-ci n'en a tenu aucun compte, ni dans les pages qu'il consacre à la Suisse, ni dans celles où il traite de Pestalozzi, qu'il rattache d'ailleurs au monde allemand, le coupant en quelque sorte de son environnement ; il traduit d'assez longs passages de Léonard et Gertrude, écrit par Pestalozzi entre 1781 et 1787, mais ne se réfère jamais à l'ouvrage de Guillaume. Sans doute tout cela avait-il été déjà rédigé, sinon imprimé avant sa rencontre avec Guillaume. On rappellera que l'ouvrage, selon une habitude de l'époque et particulièrement de l'éditeur Jules Rouff, paraissait en livraisons successives, envoyées aux abonnés toutes les deux semaines ; ce n'est qu'après que l'éditeur le publiait en volume. D'où, dans la première édition de l'ouvrage, l'absence d'une division en chapitres, ce qui en rendait la consultation et la lecture difficiles. Comme l'auteur écrivait rapidement, au fil de son inspiration et de son éloquence, le flot torrentiel de sa prose s'accommodait fort bien de cette manière de faire, mais ne se prêtait guère à des retouches. Aussi le livre de Guillaume, qui figure aujourd'hui dans la bibliothèque de Jaurès que conserve le Musée de l'histoire vivante à Montreuil, avait encore ses pages non coupées en 1973[^38]. On peut le regretter, comme on peut regretter que l'historien et tribun socialiste ne se soit pas au moins référé à l'article Pestalozzi du DP : les pages qu'il a consacrées à la Suisse et au célèbre pédagogue y auraient beaucoup gagné[^39].
Revenons à Guillaume pour relever, en conclusion, combien l'historiographie récente est en accord avec lui. On en retiendra pour preuve l'article « Instruction publique/Éducation nationale » du Dictionnaire historique de la Révolution française, commencé sous la direction d'Albert Soboul et paru en 1989, pour le bicentenaire[^40]. « Au total, y lit-on, le bilan de la Révolution en matière d'instruction publique doit être analysé moins en termes d'expériences pédagogiques ou d'établissements scolaires -- encore que cela ne soit pas nul -- que par rapport à un imaginaire fondateur. » Et l'auteur, Dominique Julia, relève, dans sa bibliographie qu'il « convient toujours de se reporter aux deux recueils essentiels publiés par J. Guillaume » : les Procès-verbaux des Comités d'Instruction publique de l'Assemblée législative, en 1889, et de la Convention, 6 volumes entre 1891 et 1907.
Certains articles de Guillaume dans les Dictionnaires méritent une attention plus particulière. C'est le cas ce celui qu'il consacre à Fichte (un peu plus de quatre colonnes, identique dans les deux dictionnaires). Sa connaissance de l'allemand et sa familiarité avec le philosophe dont il avait déjà commencé la lecture lors de ses études à Zurich expliquent sans doute son choix. Après un bref aperçu biographique, il précise qu'il n'entend pas exposer la philosophie du principal représentant de l'idéalisme allemand, mais se concentrer sur « l'application pédagogique qu'il a tenté de faire de sa doctrine [...], en posant les bases d'une réforme de l'éducation ». Et cela surtout dans ses quatorze Discours à la nation allemande. Suit une brève analyse de chacun d'entre eux, qui précède une conclusion où Guillaume voit « l'ardent champion de l'indépendance se rencontrer, à son insu peut-être, avec les hommes de la Révolution française, idéalistes comme lui, et formuler un plan d'éducation qui coïncide dans ses traits fondamentaux avec ceux qu'élaborèrent les Montagnards de 1793. [...] Les mêmes idées sur la toute puissance de l'éducation, sur le droit de l'État à s'emparer de la jeune génération pour la jeter dans un moule dont elle devait sortir transformée se retrouvent chez ceux-ci et chez celui-là. » Utopies, certes, mais qui sont le fondement d'une énergique impulsion populaire. « Leurs plans, œuvres d'esprits absolus, étaient inexécutables ; leurs doctrines philosophiques ont été rectifiées par la science expérimentale ; mais leurs aspirations vers l'égalité sont restées celles des sociétés modernes. »
Le lecteur du XXIe siècle, instruit par ce qui s'est passé au XXe, demeurera songeur à la lecture de ces lignes et devant cette approbation d'un « droit de l'État à s'emparer de la jeune génération » pour la couler dans un moule. Où donc est passé le James Guillaume de la Fédération jurassienne, se demandera-t-il ? Cette adhésion au rôle de l'État républicain ne constitue-t-elle pas ce qui conduira l'ancien internationaliste au chauvinisme outrancier de ses dernières années ? Cependant -- est-ce une réaction au nationalisme allemand dont les Discours de Fichte sont l'expression ? -- on sent, dans le texte de Guillaume, dans son ton volontairement objectif, une certaine distance, comme le montre son allusion à une rectification souhaitable due à « la science expérimentale ».
Sans que ses rédacteurs s'en soient peut-être aperçus, les questions scolaires sous la Deuxième République avaient été quelque peu négligées dans le DP. Dans sa notice consacrée à Lazare Carnot, à cause de son rôle durant les Cent-Jours où, devenu ministre de l'Intérieur, il avait élaboré un certain nombre de projets relatifs à l'enseignement, Guillaume n'avait pu s'empêcher, à la fin, de mentionner son fils, Lazare Hippolyte, ministre de l'Instruction publique de 1848, mais c'était pour ajouter aussitôt que le DP s'abstenait de consacrer des articles à des personnes encore vivantes. Dans le NDP, Lazare Hippolyte Carnot, mort entre temps, aura sa notice de 11 colonnes, non signée mais certainement due à Guillaume. On y trouve le texte intégral de son projet de loi sur l'enseignement primaire et on y apprend comment, en tant que ministre, il avait approuvé la répression des journées de Juin 1848. Cela n'avait pas empêché par la suite la réaction de se débarrasser de lui, en prenant comme prétexte son appui à la publication et à la diffusion du Manuel républicain de l'homme et du citoyen, écrit par Charles Renouvier, que l'on prétendait être une apologie du communisme. C'était la voie ouverte à Frédéric Alfred Pierre de Falloux, inspirateur des lois de 1850, plaçant l'enseignement primaire sous la tutelle de l'Église et les instituteurs sous la surveillance des préfets. Falloux, mort en 1886, put de ce fait entrer dans le NDP, avec un article de Guillaume. C'est aussi ce dernier qui est très probablement l'auteur de la notice anonyme consacrée à de Parieu, ministre de l'Instruction et des cultes au moment du vote des lois de 1850. On serait aussi tenté de lui attribuer l'article consacré à l'historien Henri Martin, disparu en 1883, qui avait répondu à l'appel de Carnot pour la rédaction d'ouvrages républicains. Guillaume a signé l'important article consacré à Charles Renouvier, mort en 1902, qui comporte de très larges passages du Manuel et des débats parlementaires qu'il avait suscités. L'analyse des idées de ce philosophe néo-kantien s'achève sur une citation très élogieuse d'Émile Boutroux, comme si Guillaume avait tenu à se placer sous l'autorité d'un philosophe reconnu. Son article consacré à Jules Barthélemy Saint-Hilaire est centré sur le rapport que celui-ci avait rédigé sur le projet Carnot de 1848, rapport qui présentait un autre projet, opposé à celui de Carnot. Les passages qu'il en cite « permettent de juger la différence qu'il y avait entre l'état d'esprit des républicains convaincus, qui, au lendemain des journées de Février, avaient essayé d'implanter pour la seconde fois la République en France, et celui des orléanistes ralliés qui voulaient continuer, sous la forme républicaine, les traditions du régime précédent ». Cet ensemble de contributions nouvelles forme une véritable histoire de l'enseignement sous la Deuxième République, histoire qui sera synthétisée et reprise dans l'article « France ».
On mettra encore au crédit de Guillaume un article non signé, qui concerne plus 1870-1871 que 1848, consacré au poète Leconte de L'Isle, dont on connaît les ardents sentiments républicains. Il avait fait paraître anonymement, à la fin de 1870, un Catéchisme populaire républicain, à la morale nettement anti-religieuse. Il y développait un projet de reconstitution politique de la France, fondé sur la commune autonome et une conception fédéraliste « caractéristique de l'époque », selon l'auteur de la notice, et tout à fait conforme à la célèbre « Déclaration au peuple français du 19 avril 1871 », c'est-à-dire au manifeste de la Commune de Paris, que, toutefois, prudent, il ne nomme pas.
Parmi les nouveaux articles introduits par Guillaume dans le NDP, il en est qui le sont par suite des découvertes qu'il a faites depuis la parution du DP. C'est le cas, on l'a vu, de l'article Pawlet, considérablement modifié et enrichi par rapport à celui du premier dictionnaire. Celui, entièrement nouveau, consacré à Antoine Lavoisier, est dû à la découverte par Guillaume, dans les papiers du célèbre chimiste, d'un texte inconnu, la minute, malheureusement incomplète, d'une lettre à Talleyrand qui avait sollicité son avis sur le rapport qu'il avait rédigé sur l'instruction publique. Bien qu'il l'ait déjà publié dans La Révolution française, James ne résiste pas à l'envie d'en reprendre l'ensemble dans le NDP. C'est que ces pages nous donnent l'image d'un « Lavoisier anti-clérical et révolutionnaire », pour reprendre le titre sous lequel il avait d'abord présenté sa découverte dans la revue[^41].
L'article « Latin » est repris tel qu'il avait paru, en 1883, dans la livraison du DP. Mais Guillaume ajoute à son premier texte un aperçu du tour pris par la discussion dans les trois années suivantes, se gardant de toute prise de position personnelle.
La collaboration de James Guillaume aux deux Dictionnaires a été essentielle ; son travail de secrétaire de rédaction, auquel Ferdinand Buisson a maintes fois rendu hommage, consistait à surveiller et contrôler les notices, depuis leur commande jusqu'à la remise du manuscrit ; à les coordonner éventuellement avec d'autres notices traitant d'un sujet apparenté ; puis à en surveiller l'impression, à en corriger les épreuves. Il fallait aussi, le cas échéant, procéder à quelques vérifications. Des tâches multiples que Guillaume accomplissait avec sa méticulosité habituelle et une remarquable conscience professionnelle. Petit détail significatif : en octobre 1907, vu l'énorme correspondance pour le NDP, la Librairie Hachette avait fait apporter au domicile de Guillaume « une presse à copier et un copie de lettres »[^42].
Outre ce côté technique et matériel, il faut souligner l'apport intellectuel de l'infatigable secrétaire de rédaction, tant dans la rédaction de ses propres articles que dans le choix des collaborateurs, dans la mesure où il pouvait y intervenir. Pour lui, on l'a vu, le côté pédagogique est toujours inséré dans son contexte historique, ce qui lui a permis de développer ses idées sur la Révolution française et de faire de ses articles « Convention » et « Pestalozzi »de véritables monographies historiques dépassant de beaucoup ce qu'on pouvait attendre d'un dictionnaire.
Tapuscrit original Marc Vuilleumier, « Les dictionnaires pédagogiques », CT MVU-D-008
Suggestion de citation
Vuilleumier Marc, « James Guillaume et les Dictionnaires de pédagogie de Ferdinand Buisson », Biographie inachevée de James Guillaume, 05.04.2025, https://www.archives-vuilleumier.ch/005-ndp
[^1]: Les deux Dictionnaires sont consultables en ligne : sur gallica.bnf.fr, le Dictionnaire de pédagogie et d\'instruction primaire, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24232h. ; le Nouveau Dictionnaire de pédagogie, http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/ (NDÉ)
[^2]: Archives d'État de Neuchâtel (AEN), fonds James Guillaume (fonds JG) 75.4, cité par Patrick Cabanel, Ferdinand Buisson : père de l\'école laïque, Genève, Labor et Fides, 2016, p.178.
[^3]: Lettre de Guillaume à G. Bréton, associé et beau-fils de Louis Hachette, 4 novembre 1910, d'après Federico Ferretti, in Le Cartable de Clio, n° 13, 2013, p.187-199, qui a consulté le fonds conservé à l'Institut mémoires de l'édition contemporaine. Cf. aussi P. Cabanel, op. cit., p. 179. Il est probable que la lettre de Guillaume ne faisait que rappeler et confirmer des conditions déjà appliquées depuis le début de son travail au Nouveau dictionnaire de pédagogie.
[^4]: En 1911, la maison d'édition Hachette a détruit tout le matériel ayant servi à l'élaboration du Nouveau dictionnaire de pédagogie, d'après Jean-Yves Mollier.
[^5]: Alexandre Fontaine, Aux heures suisses de l'école républicaine. Un siècle de transferts culturels et de déclinaisons pédagogiques dans l'espace franco- romand, Paris, Éditions Demopolis, 2015, p.143.
[^6]: AEG, fonds JG 67.3.
[^7]: International Institute of Social History (IISH), Amsterdam, Max Nettlau Papers, J. Guillaume à M. Nettlau, 27 mars et 12 avril 1907.
[^8]: C'est Patrick Dubois qui a avancé cette hypothèse, qu'il donne comme très probable. P. Dubois avec la collaboration d'Annie Bruter, Le Dictionnaire de Ferdinand Buisson. Aux fondations de l'école républicaine (1878-1911), Berne, Peter Lang, 2002, p. 28.
[^9]: Cf. Maurice Dommanget, Les grands socialistes et l'éducation, Paris, Armand Colin, p. 389-419. L'historien et ancien syndicaliste de l'enseignement primaire s'en prend assez vivement au Nouveau Dictionnaire de pédagogie qui ignore Ferrer et les autres pédagogues libertaires.
[^10]: IISH, Fritz Brupbacher Papers, J. Guillaume à F. Brupbacher, 3 décembre 1907.
[^11]: Tanguy L'Aminot, « James Guillaume et l'éducation libertaire », in Josiane Boulad Ayoub (dir.), Former un nouveau peuple ? Pouvoir, Éducation, Révolution, Montréal et Paris, Presses de l'Université Laval, L'Harmattan, 1996, p. 111.
[^12]: Michel Bakounine, Œuvres, tome V, Paris, P.V. Stock, 1911, p. 166-168. Ce long texte sur l'éducation intégrale avait paru dans L'Égalité en 1869.
[^13]: La Bataille syndicaliste, 30 janvier 1913.
[^14]: Christiane Demeulenaere-Douyère, Paul Robin (1837-1912). Un militant de la liberté et du bonheur, Paris, Publisud, 1994, p. 124-125.
[^15]: IISH, Max Nettlau Papers, Lettre de J. Guillaume à Nettlau, 30 juillet 1904.
[^16]: AEN, fonds de la famille Georges-Émile Guillaume (fonds GEG) I/5, J. Guillaume à Julie, Paris, 28 juin 1888.
[^17]: C. Demeulenaere-Douyère, op. cit., p. 285; lettre du 18 décembre 1895 à Georges Hamon.
[^18]: Documents cités par Jean-Charles Buttier, « James Guillaume et Paul Robin », jguillaume.hypotheses.org/. Consulté le 17 mai 2024, à l'adresse https://doi.org/10.58079/qkph. Buttier a en outre retrouvé, dans les cartons des Archives nationales consacrés à « l'affaire Cempuis » de 1894, une lettre de J. Guillaume du 13 septembre 1892 où celui-ci exprime les plus vives réserves à l'égard de la méthode de notation musicale de Chevé, dont s'était entiché Robin. « Pour juger de la valeur de la méthode Chevé, M. Robin, malgré son zèle, n'est pas compétent : il manque des compétences nécessaires en musique. En cette matière, c'est un simple fanatique, victime d'une illusion et tirant de certains résultats, tout matériels et mécaniques, des conclusions non justifiées. »
[^19]: Bibliothèque de Genève (BGE), Microfilm F 1144, lettre à Kropotkine, 8 avril 1904.
[^20]: Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel, fonds Gustave Jeanneret, 18 septembre 1916. Les Archives fédérales suisses, Berne, E 21/6289, dans un rapport de synthèse de 1910, rappellent cette tournée de Sébastien Faure et de ses pupilles à Genève, Lausanne et Neuchâtel (au Casino Beau-Séjour).
[^21]: Selon J. Guillaume à Monatte, 23 février 1911, Institut français d'histoire sociale, Paris, Fonds Pierre Monatte.
[^22]: IISH, Fritz Brupbacher Papers.
[^23]: BGE, Microfilm F 1144, lettre à Kropotkine, 3 janvier 1912. (Sur cette expérience et ses difficutlés, voir aussi Jean Wintsch, Charles Heimberg, L'École Ferrer de Lausanne, Lausanne, Entremonde, 2009, NDÉ).
[^24]: James Guillaume. L'émancipation par les savoirs. Colloque organisé par la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, les 22 et 23 novembre 2016. (Actes publiés : Jean-Charles Buttier, Charles Heimberg et Nora Köhler (coord.), James Guillaume. L'émancipation par les savoirs, Paris, Éditions Noir et Rouge, 2022, NDÉ).
[^25]: Article non signé dans le DP, mais signé de lui dans le NDP.
[^26]: Revue pédagogique, 15 août et 15 septembre 1891, 15 septembre 1897, articles repris dans Études révolutionnaires, deuxième série, Paris, P.V. Stock, 1909, p. 1- 125.
[^27]: Journal de Genève, 29 décembre 1787, 5 et 12 janvier 1788.
[^28]: Cf. Jean Cassaigneau et Jean Rilliet, Marc-Auguste Pictet ou le rendez-vous de l'Europe universelle : 1752-1825, Genève, Éditions Slatkine, 1995. C'est au cours d'un discours prononcé au Tribunat en 1806 que Pictet, prenant exemple sur le projet de Pawlet, proposa d'élever dans ces parages l'arc de triomphe que l'on envisageait d'élever.
[^29]: AEN, fonds GEG I/5.
[^30]: Indication donnée par Guillaume dans un de ses cahiers de poésie, AEN, fonds GEG I/8; ces cahiers n'ont pas été l'objet d'une numérotation. À Genève, très tôt, les méthodes froebeliennes, avaient trouvé des soutiens. La Liberté, petit journal radical, alors très proche de l'Association internationale des travailleurs, avait recommandé « l'introduction du système Froebel dans l'instruction primaire. » Celui-ci rendait « l'instruction tellement attrayante que les enfants se rendent à l'école avec joie et n'en sortent qu'à regret ». Friedrich Froebel, « quelque philosophe nuageux qu'il soit », avait fort bien compris la nature de l'enfant (La Liberté, 2 juin 1869). Dans son numéro suivant, le 9 juin, le journal invitait à visiter le seul jardin d'enfants de Genève, rue de Chantepoulet 5, dirigé depuis plusieurs années par M^me^ de Portagall. « Les ouvrières surtout sont plus particulièrement intéressées ». Au Conseil municipal, Hugues Darier, un radical très à gauche, qui avait sympathisé avec les idées fouriéristes, avait profité de la discussion autour de la construction d'une nouvelle école pour proposer d'y introduire la méthode Froebel (Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève, 25 mai 1869, p. 35).
[^31]: L'article a été repris sans grands changements dans le NDP.
[^32]: Michèle Élisabeth Schärer, Friedrich Froebel et l'éducation préscolaire en Suisse romande : 1860-1925, Lausanne, Haute École du travail social et de la santé, 2008, p. 19.
[^33]: Dans une lettre à Max Nettlau du 10 octobre 1910, Guillaume le charge d'une petite recherche pour son article sur Saint-Lambert. IISH, Max Nettlau Papers 559.
[^34]: AEG fonds JG 75.4, cité par P. Cabanel, op. cit., n. 178, p. 444.
[^35]: Cette notice du NDP a été récemment republiée par Pierre-Yves Ruf : James Guillaume, Un aspect oublié de la Révolution française. L'Instruction publique, Saint-Martin de Bonfossé, Théolib Sources laïques, 2014, 16l p.
[^36]: Jean Jaurès, La Convention, Paris, Jules Rouff & C^ie^, 1903, p. 547.
[^37]: James Guillaume, Pestalozzi. Étude biographique, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1890.
[^38]: Urs Brandt, « Jean Jaurès, la Révolution française et la Suisse », Annales historiques de la Révolution française, n^o^ 211, janvier-mars 1973, p. 103.
[^39]: Relevons au passage que, dans ses recherches, Jaurès avait recouru aux Archives d'État de Genève, où il avait trouvé divers documents (cf. p. 651 et 652 de sa Convention, 1ère édition).
[^40]: Dominique Julia, « Instruction publique/Éducation nationale », in Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 575-581.
[^41]: L'article, paru en 1907, a été repris dans ses Études révolutionnaires, Première période, Paris, P. V. Stock éditeur, 1908, p. 354 et sq.
[^42]: AEN, fonds JG 25.48.